26/10/2008
_Le petit guide à trimbaler de l'imaginaire français_
Le petit guide à trimbaler de l'imaginaire français : Charlotte VOLPER & Jérôme VINCENT : Les 3 souhaits - Editions ACTU-SF : 2008 : ISBN-13 978-2-917689-05-9 : 63 pages : 5 Euros (port gratuit) chez l'éditeur (http://www.trois-souhaits.com/).
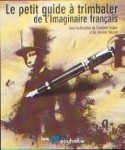
Même principe que son homologue sur la SF étrangère déjà évoqué, un petit (format 1/2 livre de poche) guide qui nous propose de découvrir l'imaginaire français. Pour les ignares come moi, imaginaire ne veut pas dire histoire inventée (par opposition à biographie ou ouvrage historique) mais = SF + Fantasy + mélange des deux.
Il présente 50 écrivains suivant le canevas standard : une dizaine de lignes de présentation, les références d'au maximum une demi-douzaine d'ouvrages (parfois moins au vu de la faible production de certains auteurs) et des suggestions de lecture (plus que dans son homologue étranger) "si vous avez aimé, alors essayez".
Certains titres ont en plus des hiéroglyphes indiquant diverses choses (dispo en occase, classique, etc...).
A ces 50 fiches auteurs s'ajoutent quelques pages thématiques.
Comme je ne suis guère un expert en SFF, je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que certains auteurs sont inclus malgré des corpus pour le moins limités (cf. Sylvie Lainé ou Armand Cabasson par exemple) et qu'il ne fait pas bon avoir été auteur du FNA puisque des gens comme Houssin ou Barbet/Maine/Sprigel sont exclus de ce guide (mais bon, il y a Brussolo et Wagner).
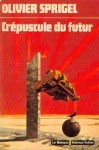
Je ne connais pas les rédacteurs de ce guide et n'ai donc rien à leur reprocher, mais pour un oeil extérieur comme le mien, il se dégage parfois de cet ouvrage un indéfinissable parfum de microcosme.
Trop léger pour donner envie d'aller plus loin, dommage.
Note GHOR : 1 étoile
15:32 | 15:32 | Ouvrages généraux sur la SF | Ouvrages généraux sur la SF | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : 1 étoile, français | Tags : 1 étoile, français
24/10/2008
_Le petit guide à trimbaler de la S.F. étrangère_
Le petit guide à trimbaler de la S.F. étrangère : Jérôme VINCENT & Eric HOLSTEIN : Les 3 souhaits - Editions ACTU-SF : 2008 : ISBN-10 2-9522502-1--9 : 74 pages : 5 Euros (port gratuit) chez l'éditeur (http://www.trois-souhaits.com/).

Voici un petit (format 1/2 livre de poche) guide qui nous propose de découvrir la SF étrangère (comprenez d'auteurs non-français ou non-francophones, je ne sais pas trop). C'est une sorte de version v2.0 du guide homonyme paru (IIRC) en 2006.
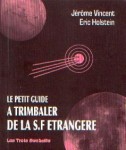
Il présente 54 écrivains de SF suivant un canevas standard : une dizaine de lignes de présentation, les références d'au maximum une demi-douzaine d'ouvrages ("A lire") et des suggestions de lecture (3 ou 4) du type "si vous avez aimé, alors essayez".
Certains titres ont en plus des hiéroglyphes indiquant diverses choses (dispo en occase, classique, etc...).
A ces 54 fiches auteurs s'ajoutent un douzaines de pages consacrées à des grand courants de la SF (Hard Science, Les précurseurs, L'uchronie...) qui brossent leur histoire et conseillent des lectures.
Cet ouvrage appelle de sa petite voix un certain nombre de commentaires de ma part :
1) le choix des auteurs :
Comme les rédacteurs nous y invitent dans la préface, le premier plaisir dans ce genre de sélection est de jouer au grand jeu du "Qui est oublié" vs. "Qui est inclus".
Je me plie donc à cet exercice dont je rappelle les contraintes, à savoir 54 places disponibles et pas une de plus.
- Dans les 54 retenus à tort (selon moi, bien sûr) :
Juan Miguel Aguilera : trois romans dont deux ne sont visiblement pas de la SF, visiblement un signe en direction de la SF ibérique.
Terry Bisson : pourtant je suis plutôt fan de l'auteur (de ses nouvelles surtout) mais je ne suis pas convaincu de sa place dans un top 54 de la SF.
Daniel Keyes : traité à juste titre de "one-hit wonder", sa place n'est pas ici.
J. Gregory Keyes : il semble que les rédacteurs adorent les Keyes, même s'ils sont des acteurs mineurs dans la SF.
Jeff Noon : s'il fait l'actualité en France, ce n'est plus un nom marquant dans les pays anglo-saxons
Lewis Shiner : un météore, surtout connu plus pour son "attitude" que ses écrits.
Karl Schroeder : c'est peut-être un peu tôt, même si je suis aussi fan de cet auteur (son côté canadien a dû lui valoir des points).
Je pourrais y ajouter Evagelisti, Morrow, Resnick ou Powers, de bons auteurs mais à mon avis pas assez importants ou marquants pour rentrer dans cette élite.
- les GRANDS absents. Même si on est dans la perception de chacun, je trouve que certaines absences sont difficilement compréhensibles pour un ouvrage visant à dresser un panorama de la SF. Peut-on imaginer un livre sur le genre qui ne traite pas de Anderson, Bujold, Le Guin,
Lem, Leiber, Sheckley, Wolfe pour les plus indiscutables. Je passe sur les auteurs de "deuxième rang" ou récents qui auraient pu remplacer certaines des sélections (Asher, Steele, McAuley, Bradley, Cherryh, Bester, Blish...).
Toujours dans le choix des auteurs, je ne suis pas pour que l'on fasse de la SF suivant la méthode des quotas mais j'ai été stupéfait de m'apercevoir que sur 54 auteurs retenus, seulement DEUX sont des femmes (Butler et Willis). On n'est pas loin du record en matière de sexisme alors que l'on a pris soin d'intégrer un quota d'européens non-anglophones (3).
2) les principes :
On pourra tout d'abord regretter que les ouvrages conseillés ne soient pas datés (ni d'ailleurs ceux cités dans les notules) et que les éditions mentionnées ne soient pas les seules ni celles les plus facilement accessibles.
Le système de liens vers d'autres livres est séduisant dans l'idée (c'est un truc que l'on voit souvent chez les anglo-saxons) mais on peut être parfois surpris par des conseils du style "si vous aimez Aldiss lisez Forward" ou "si vous aimez Sturgeon lisez Ballard".
L'absence quasi totale de traitement du champ des textes courts (pas ou peu de receuils de nouvelles conseillés, pas ou peu de mentions de nouvelles individuellement) est une lacune pour qui connaît un peu le processus de construction de la SF.
3) le ressenti :
C'est parfois approximatif (le cercle des "Trois Greg" qui est certainement une mauvaise interprétation des "killer Bs"), parfois simplement faux (Silverberg n'est pas un auteur de l'écurie Campbell même s'il a eu écrit pour lui, _I.A._ n'est pas basé sur le recueil _Supertoys_ mais sur une seule nouvelle), seulement diffamatoire (l'article sur Van Vogt qui ramène à la scientologie d'une façon grossière et peu crédible historiquement) ou carrément inventé (essayez donc de trouver une référence hors quelques sites français à la Tétralogie noire de Brunner), l'impression générale est d'une perception très branchouille (on y cite bien les auteurs à la mode dans le milieu SF & Internet) de la SF étrangère au travers d'un prisme typiquement français, ce qui est un paradoxe savoureux pour un livre voulant justement présenter la SF étrangère.
En conclusion un ouvrage un peu trop hype (et pas assez analytique), mais une petite chose sympa et pas chère. A 5 Euros, vous pouvez toujours l'offrir à vos amis.
Note GHOR : 1 étoile
13:51 | 13:51 | Ouvrages généraux sur la SF | Ouvrages généraux sur la SF | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : 1 étoile, français | Tags : 1 étoile, français
05/09/2008
_The Richard Matheson companion_
The Richard Matheson companion: Stanley WIATER, Matthew R. BRADLEY & Paul STUVE : Gauntlet Publications : 2008 : ill Harry O. Morris: ISBN-13 978-1-88736-896-4 : 569 pages (y compris biblio) : 38 Euros 98 port compris pour un HC avec jaquette.

Cet ouvrage, édité par Gauntlet Publications (une firme qui est LA spécialiste des rééditions de Matheson en version "luxe"), est ce que nos amis anglo-saxons appellent un companion, c'est à dire un volume hommage à un auteur ou à une oeuvre. C'est une façon de célébrer un auteur respecté ou d'offrir à des fans un peu de matériau annexe.
Il est structuré en quatre parties :
- un recueil de souvenirs, d'hommages et autres préfaces par la famille de l'auteur ou le gratin de l'horreur (Koontz, Ellison, Lumley...), fait de pièces généralement assez courtes (une ou deux pages et ne dépassant jamais la quinzaine) et souvent écrites du point de vue de l'émotionnel plutôt que de l'analytique.
- un court cahier photographique en N&B présentant plusieurs clichés de l'auteur et les couvertures de ses principaux livres.
- un court roman inédit (130 pages) de jeunesse de Matheson (écrit entre quatorze et seize ans) : The years stood still, que je n'ai pas lu (je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de SF).
- une bibliographie découpée en nombreux chapitres : livres, nouvelles, films, pièces etc... Par choix délibéré, elle est incomplète puisqu'elle se restreint par exemple pour les livres aux seules premières éditions (en n'oubliant toutefois pas, comme par hasard, les éditions limitées de Gauntlet). En ce qui concerne les nouvelles, elle ne donne qu'une partie des parutions, partie choisie sur des critères non-explicités dans le livre.
Par essence, ce type d'ouvrage n'a donc absolument pas de vocation critique puisqu'il a plus pour but une réminiscence positive de l'auteur qu'une analyse fouillée de son oeuvre. Du coup, le ton des articles est très proche de celui des eulogies comme on peut en lire à chaque mort d'auteur connu dans les pages de LOCUS (même si Matheson n'est pas mort). Les textes mêlent souvenirs persos (toute la famille de Matheson prend la plume et y va de son couplet) et panygériques des oeuvres de Matheson. On remarquera une concentration très (trop) importante sur I am legend & The shrinking man, à croire que Matheson n'a écrit que ces deux romans ou que le lecteur ne le connait qu'au travers des films tirés de son oeuvre.
Comme très souvent avec ce type de livre, toute cette emphase rend la lecture de la première partie assez pénible. En effet, à la dixième lecture de l'affirmation du fait que Matheson est un génie, sans que l'on tente de nous montrer pourquoi, on a parfois envie de tout laisser tomber.
Seules les parties relatives à sa carrière de scénariste apportent un certain plus et une certaine vigueur aux récits, malgré des redites d'un texte sur l'autre.
La partie bibliographique, de part ses critères d'inclusion arbitraires, est proche de l'inutile pour l'amateur de SF écrite même si elle est la seule disponible à ce jour (il en existe une dans Le livre d'or). Elle sera plus intéressante car visiblement plus exhaustive, pour les lecteurs interessé par les adaptations/créations de Matheson au cinéma ou à la télévision.
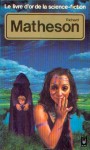
A tout cela se rajoute, en ce qui me concerne, le fait que la partie de l'oeuvre de Matheson qui m'intéresse potentiellement, à savoir ses textes de pure SF, est complètement passée sous silence à l'exception des deux romans principaux qui sont certes longuement évoqués mais pas du tout discutés. L'expression "science fiction" est d'ailleurs une des grandes absentes de l'ouvrage puisque Matheson est généralement présenté comme auteur de "fantasy".
C'est donc un livre "feel-good" mais qui se trouve être d'une superficialité assez surprenante pour un ouvrage à 50 USD. Il est clair que l'éditeur cible les lecteurs riches et déjà conquis par l'auteur et non à ceux qui chercheraient à le découvrir ou à l'approfondir.
Note GHOR : 1 étoile
10:18 | 10:18 | Etudes mono-auteur | Etudes mono-auteur | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : référence, sf, matheson, 1 étoile, anglais | Tags : référence, sf, matheson, 1 étoile, anglais
04/09/2008
_Positions and presuppositions in science fiction_
Positions and presuppositions in science fiction : Darko SUVIN (1930-) : Kent State University Press : 1988 : ill Goya : ISBN-10 0-87338-356-7 : 227 pages (y compris index et biblio) : une grosse vingtaine d'euros d'occase pour un HC avec jaquette.

Cet ouvrage est un receuil d'essais de Darko SUVIN, un des grands de la théorie SF des années 80. Il est en particulier l'inventeur du terme "cognitive estrangement" comme définition de la SF. Il postule que la SF est une littérature de l'étrange (au sens d'écart avec le réel connu ou perçu par le lecteur) mais que cet écart est connaissable par un processus cognitif (en règle générale la sciene). C'est un analyste de tendance plutôt marxiste et, chose rare chez nos amis anglo-saxons, un grand connaisseur de la SF européenne (est-européenne pour être plus précis).
Ces essais datent de 1974 à 1984 et sont parus dans l'habituelle galaxie des publications académiques spécialisées (SFS) ou non.
L'ouvrage est organisé en trois parties :
- "Some presuppositions" : deux articles qui posent les défintions à la fois de la SF et d'une théorie 'sociale' de la littérature.
- "On SF théory" : 5 articles qui creusent divers aspects du genre (les rapports entre SF et Utopie qui les lie nettement, l'enseignement critique de la SF, l'idéologie dans la SF et sa critique...).
- "Seven writers" : comme son nom l'indique, une analyse (parfois de seconde main, hélas) de sept écrivains. Cette partie traite d'Asimov, Effrémov, Lem dans un article qui les compare tous les trois, en trouvant le premier, oh surprise, comme étant le moins bon, puis consacre un article chacun à Dick, Le Guin, les Strugatsky & les Braun (un couple d'acrivains de la RDA).
Il se termine par une conclusion surtout notable par le fait qu'elle offre sur la fin un éclairage original sur un texte de Cordwainer Smith (The lady who sailed the Soul).
Il y a quelque chose de très démodé dans cet ouvrage.
Mon impression est certainement dûe aux auteurs abordés. Certains (Dick, Lem, Le Guin) sont typiques de la critique académique de l'époque (les années 80) où tout le monde voulait écrire sur eux et, même si Suvin s'en tire AMHA plutot bien sur Dick, ces articles sont un peu courts face aux livres entiers sur ces auteurs qui peuvent déployer une argumentation nettement plus fournie. En reste une impression de survol tempérée par le fait que certains auteurs abordés le sont assez rarement, par exemple les Braun, même si l'enthousiasme de Suvin parait un peu artificiel et les textes mentionnés pas particulièrement séduisants ni originaux (de toutes façons ils sont introuvables).
Ce qui donne aussi son âge à cet ouvrage est aussi la conviction implicite et explicite dans le choix des auteurs étudiés (3 Américains, 1 Polonais, 2 Russes et 1 Allemand de l'Est) que la SF est un genre véritablement international où toutes les pays participent à égalité. C'était peut- être vrai à l'époque, cela ne l'est plus maintenant où le marché du genre est indiscutablement dominé par une SF (et encore plus une Fantasy) anglo-saxonne qui, dans la plupart des pays, pèse d'un poids supérieur à la SF autochtone. Cette "Internationale de la SF" était une belle idée mais relève désormais du domaine de l'uchronie.
L'ignorant en matière de théorie littéraire que je suis a aussi trouvé certaines portions de textes un peu difficiles à suivre, par manque de connaissance des théories de Lukacs, Goldmann ou Benjamin et n'a pas été capable d'y éprouver un intérêt quelconque.
Outre une position idéologique et théorique nettement de gauche, parfois acide mais toujours rafraichissante de part sa relative rareté, la meilleure partie du livre est (AMHA) l'analyse des auteurs même si elle vire parfois à la simple description de synopsis ainsi que la démonstration des liens entre SF et Utopie (la seconde étant une branche de la première), un sujet souvent polémique de la part de tenants de la Littérature qui souhaitent conserver ce sous-genre hors des pattes sales et velues de la SF.
Au final, c'est un livre dont la pertinence dans les conditions actuelles est sévèrement limitée mais qui reste témoignage de l'état de l'art de la réflexion sur la SF il y a 20 ans.
Note GHOR : 1 étoile
08:43 | 08:43 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : sf, suvin, dick, 1 étoile, anglais | Tags : sf, suvin, dick, 1 étoile, anglais
28/08/2008
_Critical theory and science fiction_
Critical theory and science fiction: Carl FREEDMAN : Wesleyan University Press : 2000 : ill photographique de Piotr Uklanski Goya : ISBN-10 0-8195-6399-4 : 206 pages (y compris index mais pas de biblio) : 14 Euros 03 port compris pour un TP.
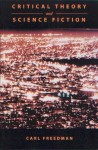
Cet ouvrage a pour vocation de montrer les parallèles possibles entre la théorie critique (qui pratique le questionnement du monde et de son fonctionnement) et la SF. En effet, ces deux activités intellectuelles sont censées utiliser des outils communs (du type prospectif) et une base de discours critique similaire, faisant logiquement de la SF le genre idéal pour illustrer le premier.
On est là dans la lignée revendiquée de Suvin et de Jameson, c'est à dire d'une analyse à base marxiste qui place la SF, grâce à ses spécifités (novum, cognitive estrangement, appareil critique) comme outil de réflexion privilégié sur la société capitaliste actuelle et ses failles (pauvreté, sexisme, racisme...).
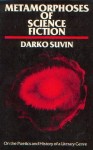

Le livre est organisé en quatre parties :
1- Definitions : comme son nom l'indique, c'est le passage obligé pour définir les deux élements (critical theory et science fiction) qui vont être corrélés. Cette partie est assez courte (20 pages).
2- Articulation : la partie la plus ardue (70 pages) qui montre donc les convergences entres ces deux élements, avec un focus revendiqué sur la critical theory.
3- Excursuses : en lien avec le chapitre précédent, une lecture critique détaillée de cinq oeuvres : Solaris (Lem), The dispossessed (Le Guin), The two of them (Russ), Stars in my pocket like grains of sand (Delany) & The man in the high castle (Dick). Chaque oeuvre donne lieu au développement d'une problématique particulière (Delany = la différence, Russ = le genre...).
4- Coda : une mise au point sur l'état des deux champs étudiés, avec en particulier une mise à mort du Cyberpunk (présenté comme simplement conservateur) remarquable de justesse, de concision et d'efficacité qui donnerait des boutons aux thuréfaires de Gibson et consorts.
La première partie commence fort, et mes connaissances limitées dans le domaine de la théorie littéraire m'ont empéché de gouter à toute l'érudition de Freedman. Pour ce qui concerne la partie SF, on est dans le classique avec à la fois une histoire relativement standard (une n-ième version de l'origine de la SF ici plutôt Poe, Verne ou Wells) et une approche théorique globalement Suvinienne. C'est toutefois correctement structuré et argumenté.
La deuxième partie m'est largement passée au dessus de la tête par manque de bagage mais se laisse lire même si Sartre, Lacan, Lukacs ne me passionnent pas.
Le troisième partie revient clairement dans le champ de la SF et dans une analyse purement marxiste de chaque ouvrage. Elle est donc du coup assez classique pour des non-américains mais certainement assez peu fréquente outre-atlantique. Techniquement, pas grand chose à en dire, particulièrement pour les textes déjà analysés de nombreuses fois (Lem, Le Guin ou Dick) où l'on arrive rapidement aux mêmes conclusions. On pourra regretter le niveau d'emphase qui est parfois (AMHA) un peu élévé, avec une présentation de PKD comme une sorte de dieu littéraire et de Delany comme le meilleur écrivain noir-américain de tous les temps.
Au delà de l'analyse littéraire opérée par Freedman, cette partie est surtout intéressante par sa sélection d'oeuvres étudiées qui, même si c'est hors du champ de ce livre, pose le problème des processus de canonisation à l'oeuvre dans le SF (pour une première approche voir l'excellent receuil d'essais Science fiction, canonization, margionalization, and the academy).

En effet, même si Freedman est parfaitement conscient du processus de formation du canon et des ses écueils, on peut dire qu'il tombe en plein dedans. Sa liste d'auteurs est d'un conformisme à faire peur. On a bien sûr une balance des sexes (soit 2 femmes et 3 hommes) dans les proportions préconisées, on a aussi l'écrivain hors USA/GB (Lem), un noir homosexuel (deux minorités d'un coup), une féministe engagée (deux de plus), une autre un peu moins (en bonus ?) et un auteur maudit génie méconnu.
Ce presque exactement les mêmes auteurs que ceux du Suvin que j'évoquais il y a peu (dans fras) : Positions and presuppositions in science fiction et surtout ce sont les auteurs que l'on retrouve à chaque fois dans toute étude sur le genre écrite par un membre du corps académique.

Sans nier les qualités de ces auteurs et de leurs oeuvres, l'amateur que je suis se pose la question de savoir si ce sont vraiment ces écrivains là qui forment le canon de la SF. Dans les cinq cités, pratiquement le seul dont le fond soit encore publié est PKD (aux USA) pour des raisons certainement liés au fait qu'il soit devenu une source de scénarios de cinéma et/ou un auteur canonique (la parution des ses oeuvres dans la Pleïade USA est symptomatique). Pour les autres, c'est le désert et certains des livres étudiés sont même difficilement trouvables d'une façon standard. Le Delany n'est disponible neuf qu'en version de luxe préfacée (surprise) par Freedman et sa dernière édition en paperback date de 18 ans. Le Russ est dans le même cas avec une seule édition dispo chez Wesleyan (re-surprise). Ces deux livres étaient donc indisponibles lors de l'écriture de cet essai et ne le sont redevenus que dans le cadre de ce qui semble être un joint-venture entre l'auteur et l'éditeur. Sur un plan pratique, on peut donc douter de l'intérêt de l'étude de tels textes.
Sur un plan théorique, je définirais (à mon humble niveau) le vrai canon de la SF comme l'ensemble des oeuvres qui trouvent encore un public malgré leur age et surtout qui touche un public "volontaire", c'est à dire un ensemble de gens qui les lit par choix et non par obligation (comme par exemple des étudiants qui les auraient dans leur cursus). Le canon de la SF, c'est par exemple Cordwainer Smith, Heinlein, Williamson ou Farmer (comme preuve supplémentaire d'une vraie permanence, on notera que ces auteurs sont aussi ressortis en VF).
Du coup, l'analyse de Freedman, même s'il est original dans le choix de deux des textes (le Delany, pour lequel on aurait plutôt attendu Dhalgren et le Russ qui aurait pû être The female man), se base sur une représentation de la SF que je juge fausse et qui ne correspond ni à l'histoire du genre, ni à sa cartographie, ni à sa réalité. C'est une vision de la SF très PC, respectable et propre sur elle qui n'aborde que des thèmes graves, à la mode et pouvant donner lieu à des papiers universitaires (gender studies, feminist theory...). C'est en tout cas bien loin des robots, fusées et autres aliens.
Un ouvrage pour universitaires, avec des vrais morceaux de SF sérieuse et aseptisée (Le Guin ^_^) dedans, mais pas forcément une image fidèle du genre dans ses attraits, ses forces ou ses enjeux.
Note GHOR : 1 étoile
09:16 | 09:16 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : 1 étoile, anglais | Tags : 1 étoile, anglais


